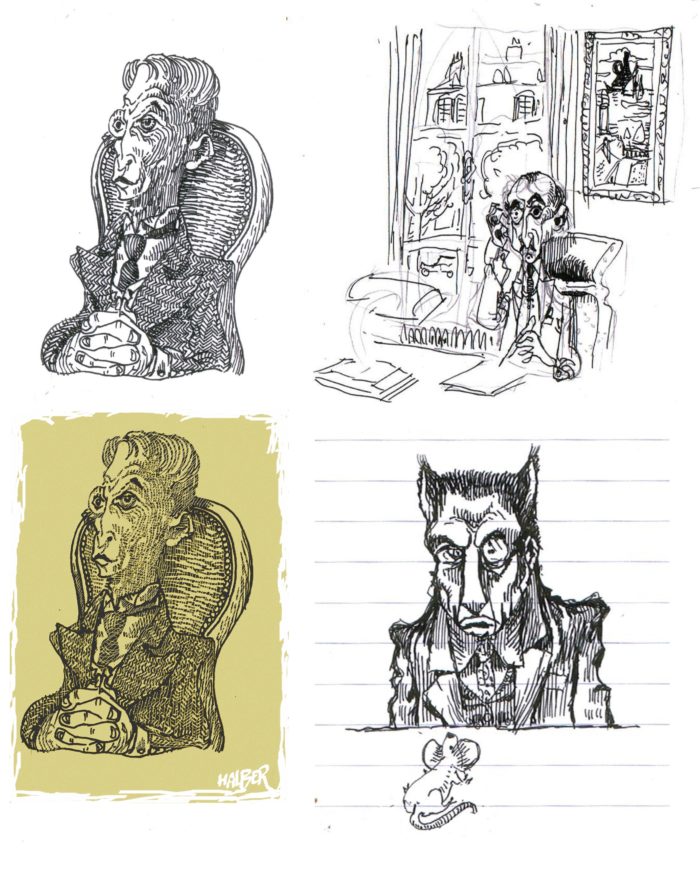Professeur de français dans un athénée de Bruxelles, à l’ULB, inspecteur de l’Enseignement au Congo belge de 1946 à 1947 (il est congédié de son poste après avoir dénoncé les mauvais traitements infligés aux enfants noirs d’écoles religieuses), poète, romancier, conteur pour enfants, nouvelliste, conférencier, traducteur de l’espagnol, Henri Cornélus (1913-1983) est un écrivain belge bien oublié à présent – seule trace : un Prix Henri Cornélus de la Nouvelle qui existe depuis 1991. Pourtant, comme tant d’autres auteurs belges des années 1940-1970 – que la critique littéraire actuelle s’obstine à occulter, leur préférant les « vedettes » du moment –, Henri Cornélus mériterait une revie littéraire. Parce qu’il incarne au mieux une image disparue : celle d’un nouvelliste-conteur dans la tradition d’un Somerset Maugham : un sujet fort, extraordinaire, une manière de conduire le récit qui capte d’emblée toute l’attention du lecteur, une manière de saisir, de mettre en avant les moments essentiels, qui dramatiques, qui cruels, de l’histoire racontée.
Henri Cornélus laisse quatre recueils. – Bakonji. Les Chefs (1955) : le Congo belge et ses envahisseurs racistes. – Ceux de la dure patience (1957) et Le Dauphin, nouvelles (1985) : la mer du Nord. – Les Hidalgos (1971) : l’Espagne et ses drames singuliers vécus par des êtres frustes : un borgne devient aveugle après avoir bu de l’eau de Lourdes (L’Œil de Nanciso) ; trompé par sa femme, un paysan l’enferme dans une cage avec une truie ; quand elle sera atrocement défigurée, il se tuera (L’Honneur).
Avec un titre qui fait référence à une lignée de récits comme en laisse le 19ème siècle (on se rappellera un titre similaire chez Balzac), El Verdugo, tiré de ce dernier recueil, raconte une histoire singulière elle aussi : après la guerre 1940-1945, un officier allemand, dont on ne saura jamais rien, arrive dans un village perdu de l’Espagne ; en butte à l’hostilité générale, il s’y fixe ; bien plus tard, il connaîtra une mort horrible…
René Godenne
EL VERDUGO
Pourquoi s’était-il fixé à Callosa de Ensarria ? Tant d’autres endroits sont plus pittoresques, plus accueillants que ce village. Il n’a d’autre horizon qu’une route droite comme une épée, des champs faits moitié de terre, moitié de cailloux sur lesquels grince le soc des charrues, puis, le séparant du reste du monde, des collines couleur de fiel où s’agite doucement la verdure de quelques arbres au tronc tourmenté. Il faut bien qu’on s’arrête quelque part. Il suffit, pour cela, que l’on soit seul, que personne ne vous parle, que le moteur fasse entendre toujours son même ronron, que, malgré les cigarettes allumées bout à bout pour chasser le sommeil qui vous guette, la fatigue vous endorme tout à coup au volant, et ne fût-ce qu’une seconde. Alors, il peut se faire qu’on s’arrête une fois pour toutes à Callosa de Ensarria.
Ceux qui vivaient déjà voici vingt ans se souviendraient toujours de cette matinée où le vent chassait les nuages vers la mer. Ils crevaient tous les quarts d’heure, tendaient dans les lointains de sombres draperies, déchargeaient sur la terre leur cargaison de pluie et, de l’unique rue de Callosa, faisaient un bourbier jaune où pataugeaient des canards dans les ruisselets gonflés de bulles.
Lancée à toute vitesse, la Volkswagen grise brillait sous les averses comme un poisson. Près de la fontaine, elle heurta une borne, dérapa dans la boue, fit un rapide tonneau avant de se coucher sur le flanc gauche. El verdugo en sortit péniblement, en tira en toute hâte une énorme serviette de cuir aux multiples compartiments bourrés à craquer.
Depuis lors, on ne l’avait jamais vu la quitter. Même lorsque, au cours d’une de ses randonnées solitaires, il s’en allait vers Confrides, vers Benassau ou, plus loin encore, vers Sella, il se la fixait sur le dos au moyen de deux solides courroies que Valeriano, le cordonnier, avait fabriquées pour lui.
Quand il eut quitté la voiture, el verdugo fit cinq pas. Bien qu’il boitât, que, déchiré à la jambe, son pantalon de toile kaki se maculât de rouge, il avait le visage aussi impassible que s’il revenait d’une promenade.
Les hommes accoururent. D’un geste, il les maintint à distance, se retourna vers l’auto, sembla attendre que quelque chose se produisît. On entendit une sourde explosion ; aussitôt après, des flammes claquèrent, coururent de l’avant à l’arrière de la carrosserie, la couvrirent tout entière. Immobile, el verdugo assista à l’agonie de sa Volkswagen, malgré la chaleur atroce, malgré la fumée noire que le vent rabattait vers lui, et qui puait le pneu carbonisé et l’essence. Il demeura ainsi jusqu’à ce que, devant lui, il n’y eût plus qu’u tas informe de tôles rougies et tordues.
Il ne dit que deux mots :
– Kaputt… Schade…
Les autres restaient à l’endroit où celui qu’ils croyaient un touriste les avait arrêtés. Ils n’osèrent s’approcher qu’au moment où l’homme se détourna du brasier.
Felipe, le forgeron, tendit l’index :
– Vous êtes blessé, Monsieur. Votre jambe…
– Comprends pas.
Puis, la main portée à la bouche comme si cette main tenait un gobelet :
« Beber1. Schnaps… »
Felipe le conduisit vers le plus proche des trois cafés de Callosa. Pourquoi ses camarades ne les suivirent-ils qu’à distance, pourquoi, une fois arrivés devant le rideau de perles qui sépare la salle de la rue, ne bougèrent-ils plus ? Pourquoi ne se parlaient-ils pas ? Le forgeron fit claquer ses paumes une contre l’autre :
– Du vin ! Du vin rouge !
Quand, le visage gras et luisant comme un beignet tiré à l’instant de l’huile, le patron apporta la bouteille, l’étranger laissa tomber quatre autres mots.
– Nein. Das nicht. Schnaps2 !
Il était huit heures du matin : on lui présenta successivement du vin blanc, de la limonade, enfin, en désespoir de cause, de l’horchata3.
De la paume, chaque fois, il faisait mine de balayer toutes ces boissons qui ne lui convenaient pas.
Le patron et Felipe comprirent enfin qu’il désirait de l’alcool. Coup sur coup, il vida à fond deux verres à vin d’aguardiente. À croire que le liquide corrosif était de l’eau. Après s’en être servi un troisième, il baissa les yeux vers la serviette, la frôla de la main avec le geste qu’il aurait eu pour flatter un chien, étendit les jambes, esquissa une grimace aussitôt réprimée, passa les doigts dans ses cheveux couleur d’orge mûre, se leva en serrant les dents, joignit les talons et, après une courbette mécanique :
– Heinrich von Falkenstein ! fit-il en tendant à Felipe une main étroite et longue.
Le forgeron y mit la sienne, se demanda si lui aussi devait s’incliner, ne se douta pas un instant que l’étranger venait de se présenter.
Devant le rideau de perles, malgré la pluie, dix hommes regardaient. Les derniers arrivés se hissaient sur la pointe des pieds. Un d’eux apprécia :
– Il sait boire, cet homme.
Dans sa voix de paysan sobre, l’étonnement se mêlait à une sorte de réprobation.
C’était le temps où, malgré les villes allemandes arrosées au phosphore, malgré les soldats feldgrau partout en déroute dans u pays aux trois quarts rasé, malgré ceux que les SS pendaient aux branches des arbres demeurés debout, après leur avoir fixé sur la poitrine un écriteau qui proclamait : Je suis un déserteur ou J’ai trahi, Goebbels vociférait le refrain cher à Hitler : « Wir werden nimmer kapitulieren ! » Sur les ondes, pour les vivants qui voulaient bien l’écouter encore, pour tous les morts dont – qui sait ? – il attendait peut-être une impossible résurrection, son fausset halluciné clamait des promesses d’armes secrètes qui détruiraient l’Angleterre, feraient reculer les Américains, pulvériseraient les Russes et, sur l’Europe affamée, exsangue, rétabliraient, pour mille ans au moins, la puissance du troisième Reich.
Après son quatrième verre d’aguardiente, l’homme grommela :
– Schlafen4.
Comme Felipe et le patron ne savaient pas ce qu’il voulait, il mit la joue sur sa paume, ferma les yeux, fit semblant de dormir.
« Schlafen », répéta-t-il un ton plus haut, la bouche crispée.
Manuel écarta les bras, secoua la tête : son San Marco n’était qu’un café, pas une posada. D’ailleurs, il n’y avait pas d’hôtel à Callosa de Ensarria.
L’étranger eut un mince sourire, glissa la main dans la poche de son pantalon, en tira une coupure de cent pesetas.
Sur lui, l’alcool ne semblait pas avoir de prise. Seuls, dans son visage hâlé, rasé de frais, ses yeux étaient devenus plus brillants. Des yeux comme il y en a peu en Espagne : leur bleu avait la délicatesse de certaines fleurs sauvages ou celle des porcelaines précieuses. On ne pouvait soutenir longtemps leur regard appuyé. Aigu comme une dague, il vous entrait dans les orbites, y faisait le vide, vidait aussi le cerveau.
– Si, señor, venez, dit le patron du San Marco en tendant la main vers la serviette.
Brutalement, du tranchant de la paume, l’autre écarté les doigts, saisit lui-même la poignée. Felipe sursauta, fit un mouvement pour se redresser, se laissa retomber sur sa chaise.
Manuel frotta son poignet endolori, glissa le billet dans la pochette de sa chemise :
« Par ici, señor ».
Lorsqu’il eut mené l’Allemand dans son grenier, lorsque, sur les planches râpeuses, il eut disposé une couche de paille et une couverture :
« Vous désirez autre chose, señor ? »
Von Falkenstein leva vers lui son regard de saurien et, avec le geste qu’il avait eu tout à l’heure pour écarter les boissons qu’il n’aimait pas :
– Raus5 !
Felipe vida un verre de rouge, rejoignit ceux qui attendaient dans la rue :
– Vous avez vu ? Et ce gros lard de Manuel qui s’est laissé faire ! Il va dormir là-haut, le señor ? Vous avez vu sa tête ? Moi, je trouve qu’il a une tête terrible. On dirait… On dirait du béton, sa tête. Et on dirait aussi qu’il a du béton à la place du cerveau.
– Quand on vient d’échapper à la mort, qu’on est fatigué et que, de plus, on est saoul, tout le monde a une tête terrible, trouva le cordonnier, avant d’ajouter gravement :
« Il n’aurait pas dû faire ce qu’il a fait à Manuel. On n’est pas des bêtes ! »
Alors, Javier, qui, après la guerre civile, avait passé un an dans les prisons franquistes et ne pouvait plus bouger le bras droit :
– C’est un Allemand. Un noble. Peut-être un Prussien. Ce sont les pires, ceux-là.
Soudain, tous se rappelèrent cette guerre lointaine dont la leur n’avait été qu’un atroce lever de rideau, cette guerre épouvantable qui s’achevait dans les pays du nord, parmi les ruines d’une Europe à moitié détruite, parmi les blessures, les brûlures, les mutilations, les cris de désespoir et de rage, les viols et la mort.
Et Javier, après avoir lancé un coup d’œil rapide à ceux qui l’entouraient, avoir vu que, devant eux, il pouvait s’épancher :
« Moi, j’aurais préféré qu’il brûle avec sa voiture, le von-je-ne-sais-pas-quoi ! Oui, qu’il crève la gueule ouverte ! Je n’aurais pas tendu le petit doigt pour l’aider.
– C’est un chrétien, intervint Valeriano. Alors, ne dis pas ça.
– Un chrétien ! C’est probablement un des porcs qui nous ont bombardés pendant la retraite. Et qui ont bombardé les femmes et les enfants, comme ça, pour s’amuser.
Il y eut un silence. Puis, Felipe :
– Pour payer son aguardiente et loger une nuit dans le grenier, il a donné cent pesetas à Manuel. Nous, il nous faut presque une semaine pour gagner ça.
– Et alors ? demanda Javier avant de hausser l’épaule gauche :
« Même si un salaud est riche, il reste un salaud ! »
Il tourna le dos à ses compagnons, s’en alla. Depuis qu’il ne pouvait plus mouvoir son bras droit – des coups de crosse, en prison, avait-il raconté un jour à Manuel – Javier ne mangeait pas tous les jours à sa faim, bricolait à gauche et à droite, s’état peu à peu aigri sous un régime qu’il détestait et dont on ne voyait pas la fin. Ne prétendait-on pas que, tous les mois, il prélevait quelques pesetas sur celles qu’il gagnait péniblement, s’achetait un cierge, le faisait brûler aux pieds de la Vierge, dans la petite église de Callosa. Certaines femmes l’avaient vu agenouillé devant la mince clarté du cierge et, lorsque l’une d’elles lui avait demandé ce qu’il désirait obtenir de la Mère, il lui avait confié :
– La mort de quelqu’un.
La femme s’était signée, s’était éloignée très vite.
– Javier, il voit des salauds partout ! ricana Valeriano.
Le troisième jour – il avait donné deux autres billets de cent pesetas au patron – l’Allemand, qui, la veille, au San Marco, avait longuement tracé des lignes et des dessins sur les feuilles grisâtres que lui avait données Manuel, les lui tendit, consulta à deux reprises un petit dictionnaire qui ne le quittait pas :
– Casa, construir6…
Il pointa l’index vers sa poitrine, fit comprendre ainsi que cette maison serait la sienne.
Pendant les vingt ans qu’il passerait au village, il en serait ainsi : il puiserait des infinitifs dans son dictionnaire, leur accolerait des noms, compléterait le tout par des mimiques. Jugeait-il que la langue du pays ne valait pas la peine d’être apprise ? Instinctivement, pour lui répondre, ceux de Callosa adopteraient le même procédé.
– Construire ! Construire ! Coûter de l’argent, beaucoup d’argent !
Devant Manuel, avec une sorte de mépris hautain, Heinrich vida toutes ses poches, entassa sur le comptoir des billets de banque chiffonnés. Les sourcils levés de plus en plus haut à mesure que s’accumulaient les coupures, l’aubergiste ne disait mot. Jamais, au grand jamais, il n’avait pu contempler une telle quantité d’argent. Heinrich feuilleta à nouveau son dictionnaire, appuya le doigt sur son sternum :
– Mucho otro. Casa, construir. Un mes7.
Cette maison, il avait voulu qu’on l’édifiât en dehors du village, sur les contreforts de la colline. Les travaux avaient été achevés en trente jours. Sans arrêt, la serviette toujours à portée de la main, il les avait surveillés, criant : « Schnell ! Schnell ! » aux hommes qui, sous le soleil, faisaient sauter le roc à coups de pioche, transportaient la terre dans de petits paniers tressés de leurs mains, préparaient le ciment, ajustaient les pierres.
Pendant tout ce mois-là, il logea dans le grenier. Le soir, alors que, à d’autres tables, les Espagnols jouaient aux dominos, il vidait ses verres d’alcool. Lorsque les joueurs rangeaient leurs rectangles d’ivoire, il lui arrivait d’inviter un d’eux à s’asseoir devant lui, à boire avec lui. Seul, Javier avait refusé d’un no cassant, qui, sur les lèvres de von Falkenstein, avait fait naître son inimitable sourire.
D’où lui était venu le surnom de el verdugo8 ? Des confidences que, après une bouteille, et à grands coups d’infinitifs, il avait murmurées à ceux qui, muets, tentaient d’éviter son regard, et, du doigt, avec l’alcool répandu, traçaient sur la table d’informes dessins ? De toutes ces confidences mises bout à bout, lorsque les hommes parlaient entre eux ?
– Il a pendu des déserteurs. Oui, pendu de ses propres mains !
– Il a tué des femmes et des enfants. Il le fallait, prétend-il. Tout le monde était franc-tireur en Russie. Les femmes et les enfants comme les autres.
– Il dit que, un jour, il a mangé un morceau de la cuisse de son camarade, tué la veille. Le ravitaillement ne suivait plus depuis une semaine.
– Dans un village, lui est ses hommes ont déshabillé trois femmes, les ont envoyées dehors, dans la nuit. Il gelait à moins vingt. Elles sont mortes debout, embrassées. Elles sont restées ainsi pendant un mois, comme des statues de pierre. À leur cou, on a accroché des panneaux de signalisation.
– Il a fait brûler des maisons, après avoir fait placer des mitrailleuses autour. Ceux qui parvenaient à s’échapper des flammes étaient abattus par ses mitrailleurs !
Quand Javier avait entendu cela, il avait grogné, la bouche haineuse :
– Des choses pareilles, on les fait peut-être pendant une guerre civile ! Pas pendant… non, pas pendant une vraie guerre ! Pourquoi est-il venu s’installer ici, avec sa pourriture d’argent ? On voit bien qu’il nous méprise tous tant que nous sommes, monsieur le major ! Et il nous méprise parce que nous ne sommes pas de sa race d’assassins, et parce que nous sommes pauvres ! À Callosa de Ensarria, on se serait bien passé de lui !
– Tais-toi, Javier ! Pendant un mois, vingt ouvriers ont été payés tous les jours comme ils n l’avaient jamais été. Et, avait continué Manuel en se frottant les mains, il donne pour son aguardiente et ses repas trois fois le prix que je lui en demande. J’ai beau essayer de refuser : quand il me regarde en me jetant les billets, il me faut bien les accepter !
– En te jetant les billets ! Tu n’es pas un homme !
Ce soir-là, une rixe faillit éclater au café. Fouetté par l’injure qu’aucun Espagnol ne laisse jamais impunie, Manuel quitta son comptoir, se dirigea vers Javier, les poings serrés, les yeux rapetissés. Il s’arrêta à un pas de lui. Les autres demeurèrent muets, ne s’interposèrent pas. En un éclair, le patron pensa au bras droit de Javier, à toutes les souffrances qu’il avait endurées dans les geôles de Franco. – Tais-toi, se contenta-t-il de dire d’une voix rauque, avant de retourner derrière le zinc où, coup sur coup, il but trois grands verres de vin rouge.
– Me taire ! Me taire ! Nous, ici, tous tant que nous sommes, sous sommes pauvres comme Job ! Monsieur le major a de l’argent à ne savoir qu’en faire ! Cette serviette, c’est peut-être le contenu de la caisse de son régiment. Pas difficile de faire le seigneur dans ces conditions-là !
Sur la table du coin, Heinrich construisait minutieusement des châteaux avec des cartes marquées de massues, de pièces de monnaie, d’épées. Il n’avait même pas levé les yeux pendant l’altercation. Ses lèvres s’étaient faites plus minces. Avait-il compris qu’on parlait de lui, que sa seule présence avait fait se dresser, un contre l’autre, deux hommes du village, deux hommes qui, jusque-là, avaient été des amis ?
Quand le calme se rétablit, il ouvrit son dictionnaire :
– Mañana… Camión… A las siete9.
– Mais il n’y a pas de camion, ici, à Callosa de Ensarria !
– Camión, a las siete, répéta l’Allemand, imperturbable.
Après avoir rasé de la paume le fragile édifice qui comptait quatre étages, il se leva, enfouit la main dans une de ses poches, lança deux billets de cent pesetas sur le comptoir, sans même daigner regarder Manuel.
Le lendemain, à sept heures du matin, le moteur d’un camion grondait devant l’auberge. Heinrich s’installa au volant, essaya les vitesses, embraya, partit dans un nuage de fumée et de poussière.
Le même soir, le véhicule revint chargé de meubles faits de ce bois sombre qu’on affectionne en Espagne. Un fusil de chasse était arrimé dans un coin. Dans un autre sommeillaient deux jeunes danois aux pattes énormes.
– Dix hommes ! avait commandé von Falkenstein.
Dix hommes s’embarquèrent dans le camion, dix hommes accompagnèrent monsieur le major jusqu’à sa maison, dix hommes déchargèrent les meubles achetés Dieu sait où. Adossé à un platane de la petite place, Javier les vit partir, un rictus au coin des lèvres :
– Des putains ! Tous des putains ! se dit-il en pensant à la serviette.
Trois semaines après, on avait entendu l’écho de coups de cravache, de gémissements venant des collines. Et Javier :
– Écoutez ! Il dresse ses chiens ! Ils deviendront grands comme des veaux. Alors, il les lancera sur nous, vous verrez !
Heinrich n’avait pas lancé ses chiens sur les habitants du village. Tous les jours, pour lui et pour eux, il achetait un kilo de bœuf.
– Nous, avait grommelé Javier, quand tout va bien, nous mangeons de la viande une fois par semaine. Ces sales bêtes-là, c’est tous les jours qu’elles en bouffent !
Un soir, tout en édifiant ses châteaux de cartes, Heinrich interrompit une partie de dominos. Il avait bu plus que de coutume :
– Mujer10, cria-t-il et, comme il l’avait fait souvent déjà, il mit le doigt sur sa poitrine.
La tête baissée, les autres firent mine de ne pas comprendre. Seul, Manuel, à voix basse :
– Mujer, señor ?
– Sí, Mujer !
– Impossible, monsieur.
Il se mouilla les lèvres, reprit :
« Callosa de Ensarria n’est pas un bordel, vous comprenez ? »
L’irritant sourire reparut sur la bouche de l’Allemand. Il montra trois cents pesetas à Manuel. Les paysans ne touchaient plus aux dominos. Le patron ne broncha pas. Heinrich ajouta d’autres billets aux premiers, les tint en éventail, alla jusqu’à mille pesetas. Comme Manuel répétait sans se lasser son « Imposible, señor », von Falkenstein ramassa l’argent, en fit une boule, la fourra dans sa poche, s’en alla très droit.
Jusque tard dans la nuit, on l’entendit chanter, là-haut, des chansons tristes et tendres, eût-on dit, puis d’autres, au rythme plus rapide, plus allègre, celles qui, sans doute, avaient accompagné ses longues marches et celles des fantassins de son pays.
Le lendemain, des détonations éclatèrent dans les collines.
– Il chasse, dit Manuel.
On sut bientôt que, des faisans, des cailles, des lièvres qu’il abattait, il n’en ramassait que trois ou quatre, pour lui et pour ses chiens, abandonnait les autres au soleil, aux fourmis, aux oiseaux de proie.
– Il tue pour le plaisir de tuer, constata Javier. Ce n’est pas permis !
Deux mois après, il y eut cette nuit très sombre où le vent effilochait d’immenses nuages. Il y eut aussi ce coup de feu qui claqua là-haut, puis ce martèlement sur la porte de Manuel. Javier entra au San Marco, montra son épaule gauche d’où dégoulinait le sang.
– Il m’a eu !
– Tu as été là-bas ? Pourquoi ?
– Comme ça. Je voulais voir ce que contenait la serviette. Je voulais…
– La voler ?
Le regard douloureux et fier de Javier :
– Toi, tu ne comprendras jamais rien ! Je voulais voir, voir seulement.
Il se laissa tomber sur une chaise :
« Tiens, au lieu de bavarder, retire-moi ces plombs. Et donne-moi une bouteille d’aguardiente. »
Il but au goulot, longuement, s’affaissa sur son siège et, près de sombrer dans l’inconscience, d’une voix pâteuse :
« Fais bouillir de l’eau. Trempes-y ton couteau. Surtout, dépêche-toi : je ne veux pas perdre l’usage de mon autre patte à cause de cet enfant de truie. »
– Les chiens ?
– Les chiens m’ont laissé approcher. Jusqu’à dix mètres de la terrasse. Puis, l’autre a tiré…
Le lendemain soir, el verdugo entra dans l’auberge, jeta un coup d’œil autour de lui, vit que Javier portait le bras en écharpe :
– Accident ? demanda-t-il aimablement.
Quand Javier se leva, Manuel s’interposa :
– Assieds-toi ! S’il déposait une plainte, si les guardias civiles venaient, tu serais frais ! Si tu retournes en prison après ceci, tu n’en sortiras plus jamais !
– Guardias civiles ? rit l’Allemand. Pas besoin guardias civiles !
Depuis lors, Heinrich ne venait plus qu’une fois par semaine au village, ne s’attablait plus au San Marco, se contentait d’y boire un verre au comptoir, emportait de Callosa ses trois bouteilles d’alcool, son pain, sa viande, ses fruits et ses conserves. Depuis lors aussi, le cordonnier lui avait fabriqué une large ceinture de cuir d’où, fixées à deux boucles, partaient de solides courroies. Chacune maintenait le collier d’un des danois. Les chiens, le mufle baveur, les yeux sournois, marchaient au pas de leur maître, se couchaient quand il s’arrêtait. Ils ne grognaient, n’aboyaient jamais, se contentaient de retrousser parfois les babines sur leurs crocs. Leur seule présence isolait l’étranger de tous les hommes, créait autour de lui un vide où personne n’eût désiré s’aventurer. On ne sentait que trop que Heinrich les avait dressés pour se jeter sur celui qui aurait été assez téméraire pour s’y risquer, qu’ils l’auraient mis en pièces sans même donner de la voix.
La première fois qu’on l’avait vu ainsi, l’Allemand avait déclaré, dans le silence qui s’était fait autour de lui et de ses gardiens :
– Moi dormir comme ça aussi. Churchill à gauche, Staline à droite. Chiens pas bouger toute nuit. Et pas aimer visites, Churchill et Staline ! Fusil aussi, pas aimer visites. Ni jour, ni nuit. Fusil toujours chargé.
À l’énoncé de leur nom, les bêtes avaient dressé les oreilles, tourné vers Heinrich un regard aussi féroce que celui qu’ils réservaient à ceux du village. On n’y lisait qu’une fidélité fanatique dénuée de cette sorte de tendresse qui illumine parfois les yeux des chiens.
– Il devrait se méfier de ces bestioles, avait dit Felipe, des bêtes pareilles, élevées seulement à la cravache et à la viande ! Puis, des danois peuvent brusquement se retourner contre celui auquel ils se sont attachés…
Pendant douze ans, les animaux n’avaient pas quitté leur maître. On voyait l’étrange attelage dans les collines, sur les collines, sur les chemins, sur la route et, régulièrement, une fois pas semaine, au San Marco. Là, Heinrich s’adossait au comptoir, Churchill et Staline couchés à ses pieds, parmi la sciure et les mégots. Il restait là, sans un mot, et ses yeux avaient la fixité soupçonneuse de ceux de ses danois. Puis, à deux semaines d’intervalle, les bêtes moururent. Elles furent remplacées par d’autres, qui devinrent tout aussi énormes, avaient, elles aussi, l’œil torve, les muscles longs et puissants, l’air méprisant et terrible, le même nom qui leur avait sans doute été donné par dérision : pour un Allemand, cravacher Churchill et Staline, n’était-ce pas une succulente vengeance, n’était-ce pas une gageure, pour lui, d’en avoir fait des sentinelles toujours en éveil, prêtes à le défendre contre tous les dangers ?
Les chiens eurent sept ans, puis huit.
Voici plus de trois semaines que Heinrich n’était plus descendu au village.
– Il serait malade ?
– M’en fous ! Depuis le temps que j’espère qu’il crèvera, celui-là !
Instinctivement, Javier avait tâté son épaule gauche de la main gauche, comme il avait appris à le faire depuis le coup de feu sur la colline.
Et, un jour, les chiens se mirent à hurler. Les échos reprenaient leurs plaintes, les lançaient à tous les vents, les étiraient interminablement comme si, au lieu de deux, il y avait eu vingt, cinquante danois dans la maison de l’Allemand.
– Il faudrait aller voir, fit Manuel
– Moi, je vous dis que le major est malade et que les bêtes ont faim.
– Le major ! Le major ! Cesse de l’appeler le major, depuis le temps !
– S’il est malade, il faut le soigner. On n’abandonne pas un homme ainsi sans essayer de l’aider.
– C’est ça ! Va le voir ! Il te tirera dessus à toi aussi ! Ou, s’il ne le fait pas, et si tu oses t’approcher de lui, ses fauves te déchireront !
Le lendemain, les molosses hurlaient toujours. Ils le firent dès lors sans arrêt, sous le soleil, puis sous la lune, puis sous le nouveau soleil.
Bien souvent, ceux du village levaient les yeux vers la maison qu’ils savaient se dresser là-haut, entre deux oliviers. La nuit, une peur obscure leur faisait vérifier, avant de se coucher, les verrous de leurs portes, la fermeture de leurs fenêtres.
– Peut-être sa vieille habitude l’a-t-elle repris, confiait Javier à qui voulait l’entendre. Peut-être, maintenant qu’il n’a plus personne d’autre à torturer, torture-t-il ses chiens !
Pendant toute une semaine encore retentirent ces cris de folie, de tristesse insondable et de mort. Quand ils cessaient un instant de s’élever, les villageois se regardaient. Dans leurs yeux, il y avait une lueur d’espoir. Puis, les plaintes reprenaient, se cognaient aux rocs, à la terre. La vieille Enriqueta, celle qui ne mangeait tous les jours que sa soupe d’orties dans laquelle elle faisait cuire deux pommes de terre, s’exclamait chaque fois, les paumes plaquées contre ses oreilles rongées par le soleil :
– Ils me rendront folle ! Ils me rendront folle ! Faites qu’ils se taisent, mon Dieu ! Faites qu’ils se taisent !
Elle se signait, se baisait le pouce, comme si, là-bas, dans le bruit inhumain, naissait une diabolique présence qui lui porterait malheur à elle, à la petite maison qu’elle occupait, à tous ceux qui étaient ses voisins.
Enfin, les hurlements se firent plus faibles. Après deux jours encore, ils cessèrent d’habiter les collines. On n’entendit plus, dans le village, que le bruit de pluie douce que faisait la fontaine et, répondant à ce murmure liquide, celui de la brise dans les arbres.
– Moi, j’y vais, dit Manuel, avant de s’armer d’un solide gourdin.
Lorsqu’il revint, trois quarts d’heure après, il était livide. Il traversa la place sans mot dire, passa parmi les autres qui l’attendaient au San Marco, s’affala sur une chaise, essuya la sueur qui, de son front, lui coulait dans les yeux.
– Alors ?
Il secoua la tête, attendit quelques secondes encore avant de parler :
– Passe-moi la bouteille. Là, celle de gauche !
Il but, fit une grimace comme s’il eût avalé du vinaigre.
– Alors ? répétait-on autour de lui.
Il prit encore le temps de s’essuyer les lèvres sur son avant-bras nu :
– Morts…
Un murmure dans la salle.
– Tous les trois ?
Manuel but une autre gorgée, fit une grimace identique :
– Tous les trois. Et pas beaux à voir, je vous assure ! Lui est couché sur son lit…
Il se tut, le regard étrangement fixe ; enfin :
« Les chiens lui ont dévoré les visage, une épaule, la poitrine, une jambe, aussi. Puis, ils se sont déchirés entre eux. Du sang partout. C’est épouvantable ! »
Javier s’avança :
– La serviette, tu l’as vue ?
– Comment peux-tu penser à la serviette, alors que…, voulut l’interrompre Vicente.
– Je te demande si tu as vu la serviette ?
– Oui. Elle est sous le lit.
– Et alors ?
– Elle contient une fortune ! Des paquets de cent, de mille pesetas. Il doit y avoir pour plusieurs millions.
– Qu’est-ce que je vous avais dit ? triompha Javier. Il s’est enfui glorieusement de la grande Allemagne, en emportant la caisse de son régiment !
– Tu accuses ! Tu accuses ! Nous ne le saurons jamais.
Sans plus attendre, Javier, de la main gauche, écarta les autres, fut sous l’immense ciel de Callosa où, tels des clous d’or maintenant une tenture d’un bleu presque noir, scintillaient les étoiles. Il alla jusqu’à la place, s’adossa à un arbre. Doucement, le feuillage chanta pour lui la chanson de mystère et de quiétude que lui dictait le vent. Et Javier commença à fredonner une mélodie, une de celles que, sous le soleil et la neige de la guerre civile, il chantait avec les camarades, une chanson qui disait que la route serait longue jusqu’à la prochaine aurore, que, un jour, pourtant, cette aurore éclairerait tous les hommes de son pays.
Quand il fut arrivé à la fin du deuxième couplet, il se secoua, parut hésiter pendant quelques secondes, se décida enfin, partit vers la colline.
Une heure après, le tocsin de Callosa de Ensarria se mit à sonner : là-bas, entre les deux oliviers dont elle dessinait tous les détails, une aube éclatante illuminait la nuit. De la maison de Heinrich von Falkenstein montaient des flammes, de longues flammes jaunes et rouges que la brise faisait danser mollement.
– Le diable ! Le diable va venir ! criait la vieille Enriqueta.
En découvrant, dans les ruines qui fumaient encore, un bout de cuir noir, à moitié carbonisé, qui tenait à la fermeture d’acier de la serviette, et, grosse comme le poing, une liasse de billets de mille pesetas rongée par le feu, on sut que l’infirme n’avait rien emporté, qu’il n’avait pas touché au trésor, que, à la faim dévorante du feu, il avait laissé les millions de l’Allemand.
On ne revit jamais Javier à Callosa de Ensarria.
Henri Cornélus
1 Boire.
2 Non. Pas cela. De l’alcool !
3 Boisson faite d’amandes pilées, d’eau et de sucre.
4 Dormir.
5 Dehors !
6 Maison, construire.
7 Beaucoup d’autre. Maison, construire. Un mois.
8 Le bourreau.
9 Demain… Camion… À sept heures.
10 Femme !